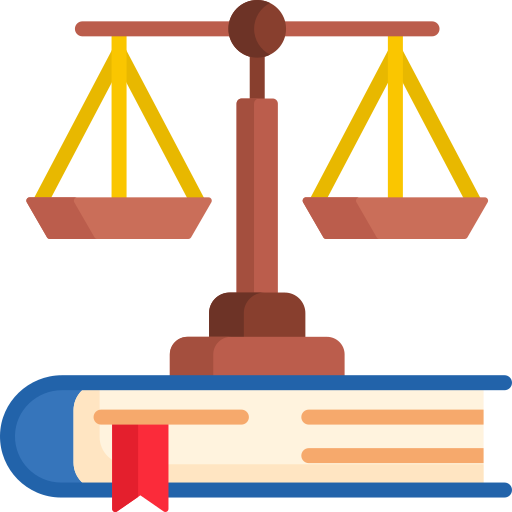Reconnaissance du harcèlement moral institutionnel par la Cour de cassation

Reconnaissance du harcèlement moral institutionnel par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation franchit un cap important en consacrant, pour la première fois, l'existence du harcèlement moral institutionnel. Elle confirme la responsabilité pénale d’une entreprise et de ses dirigeants pour la mise en œuvre d’une politique de réorganisation ayant conduit à la dégradation des conditions de travail de nombreux salariés.
Les faits à l’origine du litige
Une entreprise, confrontée à des enjeux de compétitivité, a engagé dès 2006 une politique de réduction de ses effectifs, visant 22 000 suppressions de postes sur 120 000. Cette politique a provoqué des pressions importantes sur les salariés et plusieurs suicides. À l’issue de l’enquête, l’entreprise et ses dirigeants ont été poursuivis pour harcèlement moral entre 2007 et 2010.
En 2019, le tribunal correctionnel les condamne pour harcèlement moral à l’encontre de 39 salariés, condamnation confirmée en appel. Les dirigeants forment alors un pourvoi en cassation, arguant notamment que l’article 222-33-2 du Code pénal ne viserait pas le harcèlement "institutionnel".
La position de la Cour de cassation
La Cour rejette ce pourvoi et affirme que :
- Une politique d’entreprise, même globale et impersonnelle, peut constituer du harcèlement moral dès lors qu’elle entraîne des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail.
- Il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre l’auteur et chaque victime, ni un préjudice individuel précis.
- Les dirigeants peuvent être tenus pénalement responsables, à titre de complices, s’ils ont facilité ou soutenu sciemment l’exécution de cette politique managériale.
Éléments constitutifs du harcèlement institutionnel
Deux éléments doivent être réunis :
- L’élément matériel : des actes répétés liés à l’organisation du travail ayant un effet délétère sur la santé ou la situation des salariés.
- L’élément intentionnel : la conscience et la volonté de provoquer ces effets, par des méthodes de management coercitives ou des objectifs irréalistes.
Dans cette affaire, les dirigeants avaient imposé des objectifs de départs, encouragé une gestion brutale du personnel et soutenu activement cette politique, notamment lors de formations. Leur implication était donc avérée.
Une évolution jurisprudentielle majeure
Cette décision marque un tournant : la Cour admet désormais qu’une entreprise peut être pénalement responsable pour avoir mis en place une politique institutionnelle portant atteinte aux droits des salariés, et que les dirigeants peuvent être poursuivis pour complicité, même sans contact direct avec les victimes.
Elle s’inscrit dans une volonté de moralisation des pratiques de gestion, en soulignant l’importance de prévenir les risques psychosociaux, notamment en période de restructuration. La jurisprudence antérieure, plus stricte sur le lien direct entre victime et harceleur, est ainsi assouplie.